Pleasantville - Pigments et merveilles
Où l'on revient sur une œuvre cinématographique qui s'amuse à télescoper les genres, les formats... les goûts et les couleurs. Culte. Et, en ces temps de turbulences diverses, essentiel.
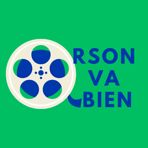

Avant toute chose, énumérons de quoi parle le film du jour. Pleasantville raconte l’histoire de David (joué par le futur Peter Parker, soit Tobey Maguire à l’état civil) dont les parents divorcent. Tandis que les professeurs de son lycée prédisent un avenir morose, pour ne pas dire mortifère, et que sa propre structure familiale se délite sans qu’il ne puisse réellement intervenir, David trouve réconfort dans une sitcom en noir et blanc (intitulée Pleasantville donc) qui a pour cadre une ville fictive des États-Unis. Une ville bien sous tous rapports, typique de l’image véhiculée dans les années 50: proprette, ensoleillée, enjouée, familiale, tranquille. Tout bascule, ou plutôt tout commence lors d’un marathon en l’honneur de ladite sitcom que David tente de regarder en dépit de la mauvaise volonté de sa sœur Jennifer (jouée par la future June Carter, soit Reese Witherspoon à l’état civil). A la suite d’un incident technique, les deux jeunes se retrouvent malencontreusement propulsés à l’intérieur de la fiction télévisée et, en attendant de revenir dans le monde réel, David et Jennifer tentent de faire plus ou moins profil bas et de se fondre dans le décor en incarnant Bud et Mary Sue, leurs doubles de fiction. Toutefois, à l’instar du postulat du “poisson hors de l’eau”, vous l’aurez évidemment déjà compris en lisant ce préambule, les choses ne vont pas se dérouler aussi simplement…
Scénariste aguerri, Gary Ross aime croiser les genres. On lui doit les pitchs aux canevas simples et pourtant efficaces de Big (1988) ou de Président d’un jour (1993), deux comédies typiques de la fausse indolence de leurs temps mais qui traduisent d’un côté les angoisses de l’âge adulte et de l’autre ce souhait, presque revendiqué, de préserver une forme de candeur face à une réalité tour à tour chaotique, violente, ordinaire et parfois extraordinaire.
C’est fort de ces deux succès publics sur son CV que Ross passe le cap de la mise en scène avec ce premier film marqué par une ambition très prononcée. Pleasantville sort en effet sur les écrans à l’automne 1998 sans que, davantage que l’originalité formelle qui le caractérise, quiconque ne réalise véritablement son importance. A son insu, cette production va incarner le relais entre un cinéma américain indépendant au summum de sa forme artistique et un Hollywood vorace qui ne jurera, ensuite, que par les franchises déclinables à l’infini. Nous sommes en 1998, donc, autant dire au siècle dernier, et le film de Gary Ross clôture ainsi une décennie anglophone qui aura vu naitre, excusez du peu, Darren Arronokfsky, Spike Jonze, James Gray, Quentin Tarantino, Sam Mendes, David Fincher, Christopher Nolan, M.Night Shyamalan ou les Wachowski. Soit, on le disait, une époque différente durant laquelle le cinéma outre-Atlantique s’appréhendait autrement; les années 90 étant celles d’une forme de renouveau où les jeunes pousses citées ci-dessus reprenaient la main au sein des majors, majors qui ne juraient que par les sempiternelles déclinaisons de Rocky, Rambo, Karaté Kid, Aigle de Fer ou et diverses franchises issues de l’ère Reagan. Tout parallèle avec la machinerie des licences cinématographiques actuelles est volontairement fortuit.
Cette progression nuancée de la couleur, perçue par les esprits les plus réfractaires comme une invasion, est à la fois une magnifique idée de cinéma doublée d’une malicieuse allégorie autour des différences.
Si l’Histoire, même celle du septième art, se répète en permanence, Pleasantville mérite donc d’être rappelé à notre bon souvenir tant le film tisse intelligemment le lien entre les cultures d’hier et les imaginaires de demain. C’est même l’essence de son parti pris artistique : un passé qui se dilue, un noir et blanc qui se colorise, un présent figé dans sa routine qui se poétise grâce à une civilisation qui se décorsète de ses raideurs et autres rancœurs sociales. Le tout par paliers, par touches, par étapes magiquement orchestrées, évidentes pourtant, et en faveur d’une désobéissance civile salutaire.
Faussement simpliste, pleinement atypique, Pleasantville laboure à contre-sens du tutélaire “c’était mieux avant”. Il y a cette scène évocatrice où, lors de son premier jour de lycée dans le décor de la sitcom, Jennifer/Mary Sue demande pendant le cours de géographie ce qu’il y a en dehors de la rue principale de Pleasantville. Hilarité générale et réponse narquoise de l’enseignante: “Mais enfin Mary Sue, après la rue principale de Pleasantville, on revient au début de la rue principale !”
Sous son apparat de stabilité, la sitcom éponyme du film de Gary Ross entretient une idéologie conservatrice qui va, sous nos yeux ébahis, se muer. Avec, et en raison des involontaires bouleversements opérés par David et Jennifer, des dérives totalitaires qui finissent inévitablement par entraver tout ce qui sortira du cadre ou de la norme. Et c’est enfoncer une porte ouverte que d’affirmer que cette progression nuancée de la couleur, perçue par les esprits les plus réfractaires comme une invasion, est à la fois une magnifique idée de cinéma doublée d’une malicieuse allégorie autour des différences.
Sentimentalisme bon teint diront certains ? Humanisme spontané rétorqueront d’autres dans lesquels, humblement, je m’inclue. A l’évidence, l’apparition de la couleur n’est pas le chaos qui survient mais une forme d’émerveillement(s) qui s’apprivoise. Passée la peur de l’inconnu, les protagonistes vont peu à peu accepter que l’inconnu, ou l’imprévu, est une nouvelle perspective. La beauté du récit est de pouvoir y apposer ce que l’on voudra: appelez cela curiosité, ou savoir, bref tout ce qui peut amener à être davantage curieux et ouvert d’esprit. Ainsi, dans une autre scène épatante, alors que les ouvrages en bibliothèque qui demeuraient vierges commencent à être empruntés, David/Bud raconte à un auditoire subjugué la suite des romans qu’il a lui-même lu, à commencer par Les aventures de Huckleberry Finn, artefact on ne peut plus transgressif de la littérature américaine. Et, sous nos mirettes ébahies, les pages des livrets vierges de se remplir au fur et à mesure de l’avancée de l’intrigue. Le tout sous la tutelle musicale de Dave Brubeck (Take Five) puis de Miles Davis (So what). Jugez plutôt:
A bien des égards, Pleasantville foisonne de ce type de scènes où le spectaculaire se mêle à l’enchantement. Une fable cinématographique culte donc, quand bien même ce terme, bien souvent galvaudé, lui sied ici comme un gant. Culte, et nécessaire, ne serait-ce que par son propos visant à transgresser la perfection afin de tenter la plus grande des aventures: s’ouvrir aux autres afin de de se découvrir soi.
ON N’EN A PAS PARLE MAIS:
- En dehors de Tobey et de Reese, il y a du beau monde qui défile également sur l’écran. Jugez plutôt: Jeff Daniels en peintre amateur sacrément doué, William H.Macy en mari désavoué, Joan Allen en épouse qui s’émancipe ou encore Jane Kaczmarek (oui, oui, la Lois de Malcolm) en mère divorcée.
- Oui, c’est bien Paul Walker qui joue le rôle de Skip et dont l’apparition dans le film se fait…au volant d’une voiture. Fast & Furious un jour, Fast & Furious toujours.
- Parmi les scènes épatantes figurent aussi celle entre Tobey Maguire qui retouche au maquillage Joan Allen en noir blanc, scène qui fera joliment écho à la quasi fin du film, ou bien ce passage à tomber par terre où, lorsque Bud emmène Margaret à l’Allée des Amoureux, des feuilles de cerisier tombent sur la route tandis qu’Etta James chante At last.
- Si Gary Ross a ensuite pris sa revanche sur le box-office (notamment avec Seabiscuit puis le premier volet de la franchise Hunger Games), il n’a jamais retrouvé la grâce -toujours intacte- de ce premier film. Qui, oui, est disponible uniquement en DVD si l’on prend le temps de farfouiller sur les Internets.
- Comme il est de bon ton de finir en musique, autant achever cette première missive et ces multiples nota benêts par le joli pied de nez musical qui conclue le film, à savoir la reprise appliquée du classique des classiques, j’ai nommé Across the universe par Fiona Apple.
Un immense merci aux lecteurs, lectrices et abonné(e)s. N’hésitez pas à partagez et à recommandez cette newsletter ainsi qu’à déposez vos retours, quolibets, compliments et impressions diverses dans la case des commentaires. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre film qui, lui aussi, télescopa les genres et les univers. Petit indice teasing de circonstance ci-dessous et sur lequel vous êtes cordialement invités à établir des pronostics.
A dans le futur !












