The Shanshank Redemption - Attendre et espérer
Où l'on revient sur ce qui demeure, tout bonnement, l'un des meilleurs films de tous les temps.
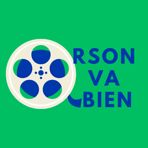

Lorsque Les Evadés The Shawshank Redemption sort sur les écrans en 1994, Stephen King est devenu une marque. Une icône littéraire devenue malgré elle une sorte de signature sur laquelle Hollywood capitalise avec convoitise. Carrie, Dead Zone, Christine, Misery, Simetierre, Ca, Shining, Cujo, Stand by me…entre les années 70 et les années 90, ce sont pas moins de deux décennies d’adaptation cinématographique qui vont entériner avec un succès certain la postérité littéraire de l’écrivain dans l’inconscient culturel.
Si le grand public connait aussi bien Stephen King, c’est aussi, et surtout donc, grâce au cinéma. Tout comme John Grisham (L’affaire Pélican, La Firme, Le client, Le droit de tuer) à une certaine époque, Hollywood achète les droits de n’importe quelle production écrite des mains de l’auteur trouble à lunettes. Nouvelles ou romans, qu’importe le sujet, le genre, le format ou le matériau, Stephen King rapporte gros. Davantage que pour son imaginaire, pourtant foisonnant ou son talent sous-estimé de conteur, c’est avec cette conviction que les spectateurs feront le déplacement également sur l’unique confiance en cette signature que les producteurs financent tout ce qui pourrait sortir du tiroir de l’écrivain. Mais si le grand public catalogue généralement Stephen King en tant qu’auteur de romans d’épouvante (ce qui reste exact), ce même grand public occulte régulièrement que l’écrivain est aussi autre chose. Et qu’il n’est jamais à son meilleur en sondant l’âme humaine que lorsqu’il déroge à son genre de prédilection. S’il est certain que l'auteur a donné de grosses sueurs froides à plusieurs générations de lecteurs, il a également livré des récits d’une émotion sans pareil, que ce soit par l’intermédiaire de Dolores Claiborne, 22/11/1963 ou au fil de ses recueils de nouvelles (Différentes saisons et Coeurs perdus en Atlantide) dont Les Evadés - Rita Hayworth or the Shawshank Redemption en anglais dans le texte- reste l’une de ses pièces maitresses.
Tim Robbins, visiblement dubitatif sur le teint irlandais de Morgan Freeman.
Avant de devenir l’un des champions des locations en vidéo et de la rediffusion télé, Les Evadés /non décidément ce titre français est affligeant de nullité/ The Shawshank Redemption sort en salles avec un succès d’estime. Salué par la critique, une jolie moisson de nominations aux Oscars à la clé, ce premier film réalisé par un certain Frank Darabont, alors totalement inconnu, passe relativement inaperçu au regard des triomphes que vont être Le Roi Lion, Speed, The Mask, Pulp Fiction ou Forrest Gump la même année. Alors comment, et même pourquoi, ce film va se frayer un chemin progressivement dans le coeur des spectateurs au point, justement, d’en oublier qu’il est un récit initialement sorti de la caboche du même géniteur que Shining et Les Tommyknockers ?
Shawshank, d’ailleurs, EST une ode à l’espoir. Sur la projection de ce qui existera après, en dehors des murs, quels que soient ces derniers
On pourra avancer mille raisons. Citons-en une évidente: comme on le stipulait plus haut, Stephen King est un conteur hors pair. Et The Shawshank Redemption est une orfèvrerie en termes de narration, laquelle est tenue par le personnage de Red, prisonnier brillamment incarné par Morgan Freeman. Toute l’histoire est donc perçue du point de vue de Red, sorte de figure magnanime qui fait consensus dans la prison, pour la simple et bonne raison que c’est lui qui s’occupe de la contrebande dans la prison. L’arrivée du personnage d’Andy Dufresne (Tim Robbins, solennel et impérial), banquier emprisonné à tort pour un meurtre qu’il n’a pas commis, va bouleverser sa routine, ses convictions et son sentiment de résignation envers un sort et un destin qui l’ont condamné trop tôt et trop vite. On ne révèlera rien, évidemment, pour les chanceux et chanceuses qui n’auraient pas encore découvert le film mais Shawshank pourrait très bien être raconté sur scène, ou à la tombée de la nuit au coin du feu; ses protagonistes et leurs péripéties, ses rebondissements, sa dynamique et son fabuleux humanisme demeurent intacts, même au millième visionnage. Signe patent, et apanage de la marque de fabrique des grands classiques, on revoit, et on re-revoit Shawshank pour cette infinité de détails, de nuances et de profondeurs qui imprègnent son récit. Et pour le plaisir de retrouver des héros subtils avec lesquels l’empathie est immédiate.
Une autre raison pour laquelle Shawshank passe avec bonheur le passage des décennies, c’est que, quand bien même l’action se déroule en grande partie en prison, donc en huis clos, Shawshank est davantage qu’un film carcéral. Au même titre qu’un Luke la main froide, grand classique contestataire des années 60 avec Paul Newman, et dont les thématiques de résistance peuvent trouver un écho avec le récit de King : sans occulter toute la noirceur qui suinte entre les murs (viols, sévices corporels, corruption, harcèlements et autres barbaries de taille humaine), Shawshank est avant tout un éloge de la fraternité. De l’amitié. C’est évidemment une farouche critique contre les conditions de détention et la question de la réinsertion; il n’y a qu’à observer comment le personnage de Brooks, merveilleux second rôle interprété par le vénérable James Whitmore, déambule hagard, esseulé et déboussolé, dans la vie civile lors du dernier tiers du film. C’est une réflexion tacite sur ce qui nous définit en tant qu’individu, en tant qu’être humain et sur notre propre capacité à concevoir l’espoir. Shawshank, d’ailleurs, EST une ode à l’espoir. Sur la projection de ce qui existera après, en dehors des murs, quels que soient ces derniers. C’est un récit qui rappelle que, contrairement à ce que l’on entend perpétuellement, les bonnes choses ne meurent jamais et qui se termine sur «I hope ». Ni une promesse, ni une affirmation. Mais une conviction.
ON N’EN A PAS PARLÉ MAIS:
- Le toujours magnifique Thomas Newman, compositeur émérite de American Beauty, Le Monde de Nemo, Les Noces Rebelles ou Les Quatre Filles du Dr March, signe là l’un de ses scores dont il a le secret, entre grandeur, suspension, espérance et volonté. Soit peut-être les quatre piliers qui structurent la morale émotionnelle du film et qui, de fait, touchent fortement le spectateur.
- Hormis avec The Majestic, Frank Darabont ne fera guère d’infidélités à Stephen King. Et si La Ligne Verte sera, pour le coup, un énorme triomphe en salles (plus de 260 millions de recettes) et The Mist une honnête, quoique dispensable, récréation régressive, aucune des deux productions n’aura la même aura sur le long terme.
- Autre exemple de la grandeur morale qui imprègne Shawshank: Andy est un modèle d’intégrité et d’éducation qui ne demande qu’à transmettre les valeurs qui le caractérisent. En plus d’être persévérant, et solidaire avec ses co-détenus, Andy aime le jeu (ce qui aura une importance inattendue), la géologie et les livres. Il finira, comme Brooks, par restaurer la bibliothèque carcérale et à aider les détenus à passer leurs examens scolaires.
- Andy collectionne les affiches des films Gilda et d’Un million d’année avant J.C. sur le mur de sa cellule.
- Si le titre de ce post est une évidente référence au Comte de Monte Cristo, le roman d’Alexandre Dumas occupe une place discrète - mais de choix- dans cette adaptation.
C’eut été une hérésie que de se quitter sans musique. Dont acte, voici un extrait de l’un des illustres passages du film qui, ironiquement, ne figure pas dans la nouvelle :
Merci aux lecteurs, lectrices et abonné(e)s qui ouvrent cette missive d’un clic. N’hésitez pas à la partagez et à la recommandez si d’ordinaire elle vous a plu. Tout retour, quolibet, compliment et impressions diverses peuvent être déposés dans la case des commentaires.











